PICON Raphaël : Ré-enchanter le ministère pastoral. Fonctions et tensions du ministère pastoral.
Lyon, Editions Olivétan, Collection Edifier & Former, 2007, 85 p, 13 €.
Présenté par Evert VELDHUIZEN.
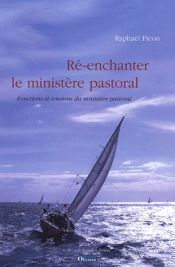
La fonction pastorale est touchée de plein fouet par les mutations profondes qui modifient le croire contemporain. Elle est également affectée par le phénomène de la « minoration » de l’identité pastorale. A partir de ces constats, l’auteur propose une tentative de ré-enchanter le ministère pastoral par une approche fonctionnelle.
La fonction du pasteur se définit par ce qu’il fait, de ce qu’il est et de son statut. La notion de fonction réinscrit le « faire » dans un champ de signification plus large. Cette approche est donc la plus apte à identifier le ministère pastoral. Cependant, aucun mot ne peut, à lui seul, « dire » le pasteur ; parce que le ministère pastoral est toujours incarné par une personne spécifique qui lui confère un style propre et le rend ainsi singulier. Ce qui demeure sans doute la plus grande richesse du ministère pastoral, c’est la personnalité, la coloration, l’unicité et la vérité de la manière d’être de celle ou de celui qui l’assume.
Le travail de réflexion théologique inspire, stimule et donne du souffle au ministère pastoral. Le pasteur est un théologien parce qu’il annonce l’Evangile et il aide les autres de trouver des mots pour dire leur foi. Puisque l’annonce de la Parole suscite l’émergence de la communauté, elle était préexistante et ne peut donc pas être soumise à l’Eglise. Ceci signifie une formidable liberté pour le pasteur et une grande responsabilité ! Le pasteur est également un écoutant. La spécificité de son écoute est d’inscrire les choses dites dans un cadre symbolique particulier, dans un espace de représentation et de signification plus large.
La fonction psychologique lui confère le rôle de témoin d’une transcendance possible et celui d’un confident. Le pasteur anime la paroisse, lui donnant du souffle qui contribue à la stimuler et à l’éveiller à l’Evangile. Sa fonction sociétale prend forme par ses propositions d’initiatives et ses suggestions de projets fédératifs. Fédérer, c’est reconnaître les uns les autres. L’ouverture que préconise l’auteur, participe de la prédication du Christ et tant qu’elle exprime et incarne l’approbation par Dieu de chacun, et qu’elle nous anime, nous décentre de nous-mêmes et nous engage dans le monde et pour les autres.
La fonction symbolique n’autorise pas le pasteur d’utiliser « le sacré » à ses propres fins. Il représente dans la société sécularisée une trace d’un ordre révolu mais encore reconnu – celui du récit chrétien qui a marqué l’histoire de notre civilisation. Il fait trace d’une préoccupation spirituelle à l’endroit de monde. Ceci introduit la définition identitaire de la fonction pastorale. Le repère ecclésial, que représente pour beaucoup de contemporains le pasteur, doit être déplacé vers l’Evangile seul dont le pasteur est un référent.
L’accumulation de tâches risque de rendre les fonctions écrasantes. Leur interdépendance ne peut cependant pas être atténuée. En tout cas, le pasteur relève d’une véritable nécessité pour l’Eglise. Celle-ci a besoin de ses ministres pour réaliser sa mission d’être la porte-parole de l’Evangile qui la fonde.
Le pasteur se trouve tiraillé entre des aspirations contrastées. On lui reconnaît son autorité ; sa fonction structurante et régulatrice est appréciée. Mais en même temps est attendu de lui qu’il valorise la liberté et l’authenticité des autres. Il n’existe pastoralement qu’en étant ainsi reconnu. Reconnu comme pasteur, il demeure en même temps lui-même, une personne avec sa vie privée. Son parcours personnel et sa personnalité le singularisent - même dans l’exercice de son ministère à caractère public.
Pouvant être marié, il est en quelque sorte arraché à la tutelle de l’Eglise. Le conjoint est un « élément sainement anticlérical ». Marié, le pasteur est une personne qui échappe en partie au contrôle et aux regards de la communauté. Sa vie privée maintient l’altérité nécessaire de sa parole. Son jour de congé hebdomadaire le libère. Car cette indisponibilité relative résiste à l’urgence de l’immédiateté imposée. Elle aide à maintenir l’équilibre du ministère. La préservation du domaine privé de celui-ci reviendrait à préserver l’Evangile lui-même dans sa centralité. En effet, le pasteur doit gérer la tension entre le « je » et le « nous ». Tout en participant à la communauté, il reste lui-même.
Constatant une tendance à la « professionnalisation » du ministère, l’auteur s’arrête également sur la tension entre la vocation et la profession, entre l’appel spirituel et le métier exercé avec compétence. Compétences, expériences et savoir-faire ne suffissent pas en soi. Il faut être personnellement motivé, appelé par un autre et être en quelque sorte prédestiné à accomplir ces différentes fonctions. Prédestiné au sens d’être naturellement enclin à faire cela - reconnaissable par les autres. Les diverses tensions qui traversent les fonctions pastorales ne sont pas forcément gênantes. Au contraire même ; ces tensions peuvent aider à structurer l’hiérarchie de ses aspects et à tenir en permanence le nécessaire équilibre - toujours à chercher à l’intérieur de l’exercice.
L’auteur conclut sa réflexion en constatant la nécessité du ministère pastoral dans le monde et l’utilité de ses fonctions dans l’Eglise. Il formule le vœu que le ré-enchantement du ministère pastoral puisse contribuer au ré-enchantement du monde.

Association des pasteurs de France

Copyright 2009